- UN RÉGISSEUR OPTIMISTE.
- TROIS SPECTATEURS DANS UNE SALLE.
- UNE COLLATION MAGIQUE.
- LE PUBLIC DE COLCHESTER ET LES NOISETTES.
- RETOUR EN FRANCE.
- JE CÈDE MON THÉATRE.
- VOYAGE D’ADIEU.
- RETRAITE A SAINT-GERVAIS.
- PRONOSTIC D’UN ACADÉMICIEN.
Quelque temps après cette séance, mon engagement se terminait avec Mitchell.
Au lieu de rentrer en France comme je l’eusse tant désiré après une aussi longue absence, je
pensai qu’il était plus favorable à mes intérêts de continuer mes excursions dans les provinces
anglaises jusqu’au mois de septembre, époque où j’espérais faire la réouverture de mon théâtre à
Paris.
En conséquence, je me traçai un itinéraire dont la première station devait être Cambridge, ville
renommée par son Université, et je partis.
Mais peut-être le lecteur n’a-t-il pas envie de me suivre dans cette longue excursion. Qu’il se
rassure; je ne le ferai pas voyager avec moi, d’autant plus que ma seconde course à travers
l’Angleterre ne présente presque aucun détail qui soit digne d’être mentionné ici. Je me contenterai
de raconter quelques incidents, et entre autres, une petite aventure qui m’est arrivée, parce qu’elle
peut servir de leçon aux artistes, quels qu’ils soient, en leur apprenant qu’il est dangereux pour leur
amour-propre et pour leurs intérêts d’épuiser trop à fond la curiosité publique, dans les différentes
localités où l’espoir de bonnes recettes les conduit.
Je devais, ainsi que je viens de le dire, aller directement de Londres à Cambridge, mais à moitié
route, j’eus la fantaisie de m’arrêter à Herford, petite ville d’une dizaine de mille âmes, pour y
donner quelques représentations.
Mes deux premières séances eurent un très grand succès; mais à la troisième, voyant que le
nombre des spectateurs avait de beaucoup diminué, je me décidai à n’en pas donner d’autres.
Mon régisseur combattit cette résolution, et il me donna des raisons qui ne manquaient
certainement pas de valeur.
—Je vous assure, Monsieur, me dit-il, que dans la ville on ne parle que de votre séance. Chacun
me demande si vous devez jouer encore demain, et déjà deux jeunes gens m’ont chargé de retenir
leurs places pour le cas où vous vous détermineriez à rester.
Grenet, c’était le nom du régisseur, était bien le meilleur homme du monde. Mais j’aurais dû me
méfier de ses conseils, en raison de sa disposition d’esprit à voir tout en beau. C’était l’optimisme
incarné. Les supputations de succès qu’il me fit pour la séance future eussent laissé bien loin derrière
elles celles de l’inventeur d’écritoires. A l’entendre, il fallait doubler le prix des places et augmenter
le personnel du théâtre, pour contenir la foule qui devait venir me visiter.
Tout en plaisantant Grenet sur l’exagération de ses idées, je consentis néanmoins à ce qu’il fit
poser les affiches pour la représentation qu’il me demandait.
Le lendemain, à sept heures et demie du soir, je me rendis, selon mon habitude, à la porte du
théâtre pour donner l’ordre de faire ouvrir les bureaux et de laisser entrer le public. La séance devait
commencer à huit heures précises.
Je trouvai mon régisseur complétement seul. Pas une âme ne s’était encore présentée; cependant
cela ne l’empêcha pas de m’aborder d’un air radieux; c’était du reste son air normal.
—Monsieur, me dit-il en se frottant les mains, comme s’il avait eu à m’annoncer une excellente
nouvelle, il n’y a encore personne à la porte du théâtre, mais c’est bon signe.
—C’est bon signe, dites-vous? Ah ça! mon cher Grenet, comment me prouverez-vous cela?
—C’est très facile à comprendre; vous avez dû remarquer, Monsieur, qu’à nos dernières séances
nous n’avions eu que l’aristocratie du pays.
—Rien ne me prouve qu’il en ait été ainsi, mais je vous l’accorde; après?
—Après? c’est tout simple. Le commerce n’est point encore venu nous visiter, et c’est
aujourd’hui que je l’attends. Ces négociants sont toujours si occupés, qu’ils remettent souvent au
dernier jour pour se procurer un plaisir. Patience, vous allez voir, dans un instant, l’assaut que nous
aurons à soutenir!
Et il regardait vers la porte d’entrée, de l’air d’un homme convaincu que ses prévisions se
réaliseraient.
Nous avions encore une demi-heure, c’était plus qu’il n’en fallait pour remplir la salle.
J’attendis. Mais cette demi-heure se passa dans une vaine attente; personne ne se présenta au bureau.
—Voici huit heures, dis-je en tirant ma montre; nous n’avons pas encore de spectateurs: qu’en
dites-vous, Grenet?
—Ah! Monsieur, votre montre avance; ça, j’en suis sûr, car…..
Mon régisseur allait appuyer cette affirmation de quelque preuve tirée de son imagination,
lorsque l’horloge de l’Hôtel-de-Ville sonna. Grenet se trouvant à bout de raisons, se contenta de
garder le silence en jetant, toutefois, un coup-d’oeil désespéré vers la porte.
Tout à coup je vois sa figure s’empourprer de plaisir.
—Ah! je l’avais bien dit, s’écrie-t-il en me montrant deux jeunes gens qui se dirigeaient de notre
côté; voilà le public qui commence à arriver, on se sera sans doute trompé d’heure. Allons! chacun à
son poste!
La joie de Grenet ne fut pas de longue durée; il reconnut bientôt dans ces visiteurs les deux
jeunes gens qui avaient retenu leurs places dès la veille.
—On n’a pas envahi nos stalles, crièrent-ils à l’optimiste, en se hâtant d’entrer.
—Non, Messieurs, non; vous pouvez entrer, répondit Grenet en faisant une imperceptible
grimace. Et il les conduisit complaisamment, en cherchant à leur donner un motif sur le vide de la
salle qu’il prétendait momentané.
Il était à peine revenu au bureau qu’un monsieur d’un certain âge monte en toute hâte le péristyle
du théâtre et se précipite vers le contrôle avec un empressement que mes succès des jours précédents
pouvaient justifier.
—Pourrai-je avoir encore une place, dit-il d’une voix essoufflée?
A cette demande qui semble une raillerie, mon pauvre Grenet abasourdi ne sait plus que
répondre; il se contente d’adresser à son interlocuteur une de ces phrases banales que l’on emploie
souvent pour gagner du temps.
—Mon Dieu! Monsieur, voyez-vous….. il faut que vous sachiez…..
—Je sais, Monsieur, je sais; il n’y a plus de places; je m’y attends; mais de grâce, laissez-moi
entrer, et je trouverai toujours bien quelque petit coin pour me caser.
—Permettez-moi donc, Monsieur, de vous dire…
—C’est inutile…
—Mais puisque, au contraire…
—A la bonne heure! Donnez-moi alors une stalle, et je vais voir si je puis me placer dans un des
couloirs.
A bout d’arguments, Grenet délivra le billet.
On peut se figurer l’étonnement de l’ardent visiteur, quand en entrant dans la salle il s’aperçut
qu’il composait à lui seul le tiers de l’assemblée.
Quant à moi, j’eus bientôt pris mon parti sur cette déconvenue. C’était, il est vrai, un four que je
faisais, mais ce four se présentait d’une façon si originale que, en raison de sa singularité, je le
regardais comme une diversion à mes succès passés; je voulus même le faire tourner à l’agrément de
ma soirée. On n’est pas, je crois, plus philosophe.
Ce fut avec une sorte de satisfaction que je vis les alentours du théâtre complétement déserts.
Après avoir donné, pour l’acquit de ma conscience, le quart d’heure de grâce aux retardataires,
ne voyant venir personne, je fis annoncer à mes trois spectateurs que, n’écoutant que mon désir de
leur être agréable, j’allais donner ma représentation.
Cette nouvelle inattendue souleva dans la salle un triple hurrah sous forme de remerciement.
J’avais pour orchestre huit musiciens, amateurs de la ville. Ces artistes, vu ma qualité de
Français, jouaient, chaque soir, pour ouverture, l’air des Girondins et la Marseillaise à grand renfort
de grosse caisse, de même qu’ils ne manquaient jamais de terminer la séance par le God save the
queen.
L’introduction patriotique terminée, je commençai ma séance.
Mon public s’était groupé sur le premier banc de l’orchestre, de sorte que pour m’adresser à lui
dans mes explications, j’aurais été obligé de tenir la tête constamment baissée et dirigée vers le
même point; cela aurait fini par être fort incommode. Je pris le parti de porter mes regards dans la
salle et de parler aux banquettes, comme si je les eusse vues animées pour moi d’une bienveillante
attention.
Je fis dans cette circonstance un véritable tour de force, car je déployai, pour l’exécution de mes
expériences, le même soin, la même verve, le même entrain que devant un millier d’auditeurs.
De son côté, mon public faisait tout le bruit possible pour me prouver sa satisfaction. Il
trépignait, applaudissait, criait, de manière à me faire presque croire que la salle était complétement
garnie.
La séance entière ne fut qu’un échange de bons procédés, et chacun des spectateurs vit avec peine
arriver la dernière de mes expériences. Celle-là n’était pas indiquée sur l’affiche; je la réservais
comme la meilleure de mes surprises.
—Messieurs, dis-je à mon triple auditoire, j’ai besoin, pour l’exécution de ce tour, d’être assisté
de trois compères. Quelles sont les personnes parmi l’assemblée qui veulent bien monter sur la
scène?
A cette comique invitation, le public se leva en masse et vint obligeamment se mettre à ma
disposition.
Les trois assistants consentirent à se ranger sur le devant de la scène, avec promesse de ne point
regarder derrière eux. Je leur remis à chacun un verre vide, en leur annonçant qu’il se remplirait
d’excellent punch aussitôt qu’ils en témoigneraient le désir, et j’ajoutai que, pour faciliter l’exécution
de ce souhait, il faudrait qu’ils répétassent après moi quelques mots baroques tirés du grimoire de
l’enchanteur Merlin.
Cette plaisanterie n’était proposée que pour gagner du temps, car tandis que nous l’exécutions en
riant aux éclats, un changement à vue s’opérait derrière mes aimables compères. La table sur laquelle
j’avais exécuté mes expériences était remplacée par une autre garnie d’une excellente collation. Un
énorme bol de punch brûlait au milieu.
Grenet, vêtu de noir, cravaté de blanc, armé d’une cuillère, en stimulait la flamme bleuâtre, et
lorsque mes compères exprimèrent la volonté de voir leurs verres se remplir de punch:
—Retournez-vous, leur dit-il de sa voix la plus grave, et vous allez voir vos souhaits accomplis.
Ce fut un coup de théâtre pour mes trois adeptes, qui restèrent un instant ébahis de surprise, ce
qui me donna le loisir de compléter l’expérience en faisant emplir leurs verres.
Les musiciens avaient été les spectateurs de cette petite scène; je les priai de venir se joindre à
nous pour éprouver la vertu de mon bol inépuisable. Cette invitation fut joyeusement acceptée; on
entoura la table, on emplit les verres, on les vida, et nous ne passâmes pas moins de deux heures à
deviser sur l’agrément de cette expérience.
Grâce à la prodigalité de l’inexhaustible bowl of punch, mes convives furent tous saisis d’une
tendre expansion. Peu s’en fallut qu’on ne s’embrassât en se quittant; on se contenta cependant de se
serrer la main, en se promettant mutuellement le plus amical souvenir.
L’enseignement que l’on peut tirer de cette anecdote, c’est que, pour présenter ses adieux au
public dans un théâtre, il ne faut pas attendre qu’il n’y soit plus pour les recevoir.
Au sortir d’Herfort, je me rendis à Cambridge, puis à Bury-Saint-Edmond, à Ipswich et à
Colchester, faisant partout des recettes proportionnées à l’importance de la population. Je n’ai
conservé de ces cinq villes que trois souvenirs: le fiasco d’Herfort, l’accueil enthousiaste des
étudiants de Cambridge et les noisettes de Colchester.
Mais, me demandera-t-on, quel rapport peut-il y avoir entre des noisettes et une représentation de
magie? Un mot mettra le lecteur au courant du fait et lui expliquera toutes les tribulations que ce fruit
m’a causées.
Il est d’usage dans la ville de Colchester, lorsque l’on va au spectacle, de remplir ses poches de
noisettes; d’ailleurs, n’en a-ton pas chez soi, qu’on trouve à en acheter à la porte du théâtre. On les
casse et on les mange pendant le cours de la représentation, sous forme de rafraîchissements.
Hommes et femmes ont cette manie cassante, en sorte qu’il s’établit dans la salle un feu roulant de
bris de noisettes qui, par moments, devient assez fort pour couvrir la voix; l’artiste qui est en scène
en est quitte pour répéter la phrase qu’il pense n’avoir pas été entendue.
Rien ne m’agaçait les nerfs comme cet incessant cliquetis. Ma première représentation s’en
ressentit, et malgré mes efforts pour me maîtriser, je fis ma séance tout entière sur le ton de
l’irritation. Malgré cet ennui, je consentis à jouer une seconde fois; mais le le directeur ne put jamais
me décider à lui accorder une troisième représentation. Il eut beau m’assurer que ses artistes
dramatiques avaient fini par se faire à cette étrange musique; que même il n’était pas rare de voir en
scène un acteur secondaire casser une noisette en attendant la réplique, je le quittai, ne voulant pas en
entendre davantage.
Décidément les théâtres des petites villes anglaises sont loin de valoir ceux des grandes cités.
A Colchester devait s’arrêter ma tournée, et je me disposais à plier bagage pour la France,
lorsque Knowles, le directeur de Manchester, se rappelant mes succès à son théâtre, vint me proposer
d’entreprendre avec lui un voyage à travers l’Irlande et l’Ecosse. Nous étions alors au mois de juin
1849. Paris, on se le rappelle, était alors plus que jamais agité par les questions politiques; les
théâtres en France n’existaient que pour mémoire. Je ne fus pas longtemps à me décider; je partis
avec mon english menager.
Notre excursion ne dura pas moins de quatre mois, et ce ne fut que vers la fin d’octobre que je
remis le pied sur le sol français.
Ai-je besoin de dire le bonheur avec lequel je me retrouvai devant le public parisien, dont je
n’avais pas oublié le bienveillant patronage? Les artistes qui, comme moi, ont été longtemps absents
de Paris, le comprendront, car ils savent que rien n’est doux au coeur comme les applaudissements
donnés par des concitoyens.
Malheureusement, lorsque je repris le cours de mes représentations, je m’aperçus avec peine du
changement qui s’était opéré dans ma santé; ces séances, que je faisais jadis sans aucune fatigue, me
jetaient maintenant dans un pénible accablement.
Il m’était facile d’attribuer une cause à ce fâcheux état. Les veilles, les fatigues, l’incessante
préoccupation de mes représentations et plus encore l’atmosphère brumeuse de la Grande-Bretagne,
avaient épuisé mes forces. Ma vie s’était en quelque sorte usée pendant mon émigration. Il m’eût fallu
pour la régénérer un long repos, et je ne devais pas y songer à cette époque, au milieu de la meilleure
saison de l’année. Je ne pus que prendre des précautions pour l’avenir, dans le cas où je me
trouverais tout à fait forcé par ma santé de m’arrêter. Je me décidai à former un élève qui me
remplaçât au besoin et dont le travail pût, en attendant, me venir en aide.
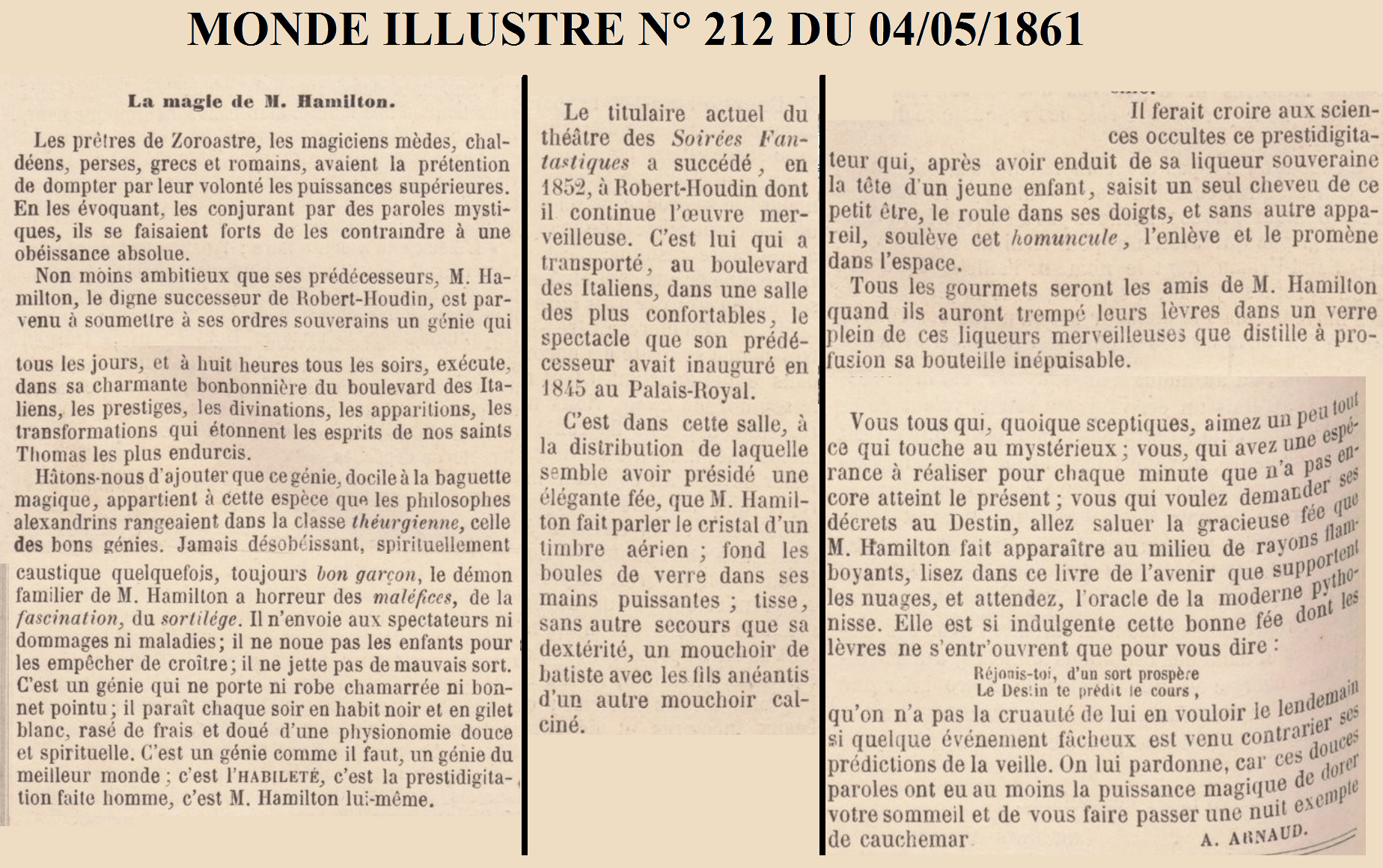
Un artiste d’un extérieur agréable et dont je connaissais l’intelligence, sembla me présenter les
conditions que je pouvais désirer. Mes propositions lui convinrent; il entra aussitôt chez moi. Le futur
prestidigitateur montra du reste de l’aptitude et un grand zèle pour mes leçons; je le mis en peu de
temps à même de préparer mes expériences, puis il m’aida dans l’administration de mon théâtre, et
lorsque vinrent les grandes chaleurs de l’été, en 1850, au lieu de fermer ma salle, selon mon
habitude, je continuai de faire poser des affiches dans Paris; seulement mon nom fut remplacé par
celui d’Hamilton.
Eu égard à son peu d’études, mon remplaçant provisoire ne pouvait être encore très fort; mais il
était convenable dans ses expériences, et le public se montra satisfait. Pendant ce temps, je goûtais à
la campagne les douceurs d’un repos longtemps désiré.
Un homme qui a fait une longue route ne ressent jamais plus vivement la fatigue que lorsque,
après s’être arrêté quelques instants pour se reposer, il veut continuer son voyage. C’est ce que
j’éprouvai quand, le terme de mes vacances arrivé, il me fallut quitter la campagne pour
recommencer l’existence fébrile du théâtre. Jamais je ne ressentis plus de lassitude; jamais aussi je
n’eus un désir plus vif de jouir d’une complète liberté, de renoncer à ces fatigues à heure nommée,
qu’on peut appeler justement le collier de misère.
A ce mot, je vois déjà bien des lecteurs se récrier. Pourquoi, diront-ils, nommer ainsi un travail
dont le but est d’émerveiller une assemblée, et le résultat de procurer honneur et profit?
Je me trouve forcé de justifier mon expression.
Le lecteur comprendra facilement que les fatigues, les préoccupations et la responsabilité
attachées à une séance de magie n’empêchent pas le prestidigitateur d’être soumis aux autres misères
de l’humanité. Or, quels que soient ses chagrins ou ses souffrances, il doit cependant chaque soir et à
heure fixe les refouler dans son coeur pour revêtir le masque de l’enjouement et de la santé.
C’est déjà, croyez-moi, lecteur, une pénible tâche, mais ce n’est pas tout, il lui faut encore, et
ceci s’applique à tous les artistes en général, il lui faut, sous peine de déchéance, égayer, animer,
surexciter le public, lui procurer enfin, disons-le mot, du plaisir pour son argent.
Pense-t-on que cela soit toujours chose facile?
En vérité, la situation qui est faite aux artistes serait intolérable, s’ils ne trouvaient pas dans la
sympathie et les applaudissements du public une douce récompense qui leur fait oublier les petites
misères de la vie.
Je puis le dire avec orgueil: jusqu’au dernier jour de ma vie artistique, je n’ai rencontré que
bienveillance et sympathie; mais plus je m’efforçais de m’en montrer toujours digne, plus je sentais
que mes forces diminuaient, et plus aussi augmentait en moi le désir de vivre dans la retraite et la
liberté.
Enfin, vers le mois de janvier 1852, jugeant Hamilton apte à me succéder, je me décidai à lui
céder mon établissement, et, pour que mon théâtre, l’oeuvre de mon travail, restât dans ma famille, on
passa deux contrats: le même jour, mon élève devint mon beau-frère et mon successeur.
Cependant quelque avide que soit un artiste de rentrer dans la vie tranquille et solitaire, il est
bien rare qu’il renonce tout-à-coup et pour toujours à mériter les applaudissements dont il s’est fait
une douce habitude. On ne sera donc pas étonné d’apprendre que je voulus, après m’être reposé
pendant plusieurs mois, donner encore quelques représentations, avant de prendre définitivement
congé du public.
Je ne connaissais pas l’Allemagne; je gagnai les bords du Rhin. Désirant ne pas me fatiguer, je
résolus de me réserver le choix des lieux où je donnerais mes représentations. Je m’arrêtai donc de
préférence dans ces séjours de fête que l’on nomme des villes de bains, et je visitai successivement
Bade, Wiesbaden, Hambourg, Ems, Aix-la-Chapelle et Spa. Chacune de mes séances, ou peu s’en
faut, fut honorée de la présence d’un ou de plusieurs des Princes de la Confédération Germanique.
Mon intention était de rentrer en France après les représentations que j’avais données à Spa,
lorsque, à la sollicitation du directeur d’un théâtre de Berlin, M. Engel, je me décidai à retourner sur
mes pas, et je partis pour la capitale de la Prusse.
J’avais contracté avec M. Engel un engagement de six semaines; mon succès et aussi les
excellentes relations que j’eus avec mon directeur me firent prolonger pendant trois mois mon séjour
à Berlin. Je ne pouvais, du reste, prendre congé du public d’une manière plus brillante; jamais peutêtre
je n’avais vu une foule plus compacte assister à mes séances. Aussi, l’accueil que j’ai reçu des
Berlinois restera-t-il dans ma mémoire parmi mes meilleurs souvenirs.
De Berlin, je me rendis directement près de Blois, dans la retraite que je m’étais choisie.
Quelle que fût ma satisfaction de jouir enfin d’une liberté si longtemps désirée, elle eut bientôt
subi le sort commun à tous nos plaisirs, et elle n’eût pas manqué de s’émousser par la jouissance
même, si je n’avais réservé pour ces heureux loisirs des études dans lesquelles j’espérais trouver une
distraction sans cesse renaissante. Après avoir acquis un bien-être matériel à l’aide de travaux traités
bien à tort de futiles, j’allais me livrer à des recherches sérieuses, ainsi que me le conseillait jadis un
membre de l’Institut.
Le fait auquel je fais allusion remonte à l’époque de l’exposition de 1844, où je présentai mes
automates et mes curiosités mécaniques.
Le jury chargé de l’examen des machines et instruments de précision s’était approché de mes
produits, et j’avais, en sa présence, renouvelé la petite séance donnée quelques jours auparavant
devant le roi Louis-Philippe.
Après avoir écouté avec intérêt le détail des nombreuses difficultés que j’avais eu à surmonter
dans l’exécution de mes automates, l’un des membres du jury prenant la parole:
—C’est bien dommage, Monsieur Robert-Houdin, me dit-il, que vous n’ayez pas appliqué à des
travaux sérieux les efforts d’imagination que vous avez déployés pour des objets de fantaisie.
Cette critique me blessait d’autant plus, qu’à cette époque je ne voyais rien au-dessus de mes
travaux, et que dans mes plus beaux rêves d’avenir, je n’ambitionnais d’autre gloire que celle du
savant auteur du canard automate.
—Monsieur, répondis-je d’un ton visiblement piqué, je ne connais pas de travaux plus sérieux
que ceux qui font vivre un honnête homme. Toutefois je suis prêt à changer de direction si vous m’en
donnez l’avis après que vous m’aurez écouté.
A l’époque où je m’occupais d’horlogerie de précision, je gagnais à peine de quoi vivre.
Aujourd’hui, j’ai quatre ouvriers pour m’aider dans la confection de mes automates; le moins habile
gagne six francs dans sa journée; jugez ce que je dois gagner moi-même.
Je vous demande maintenant, Monsieur, si je dois retourner à mon ancienne profession.
Mon interlocuteur se tut, mais un autre membre du jury s’approchant de moi, me dit à demi-voix:
—Continuez, Monsieur Robert-Houdin, continuez; j’ai l’assurance que vos ingénieux travaux,
après vous avoir conduit au succès, vous mèneront tout droit à des découvertes utiles.
—Monsieur le baron Séguier, répondis-je sur le même ton, je vous remercie de votre
encourageant pronostic; je ferai mes efforts pour le justifier[18].
J’ai suivi l’avis de l’illustre savant, et je m’en suis fort bien trouvé.
 Prestidigitation Un site sur l'illusionnisme et la prestidigitation
Prestidigitation Un site sur l'illusionnisme et la prestidigitation




